Les forêts communautaires participent à l’aménagement pour de multiples valeurs à plusieurs échelles dans des paysages de plus en plus incertains
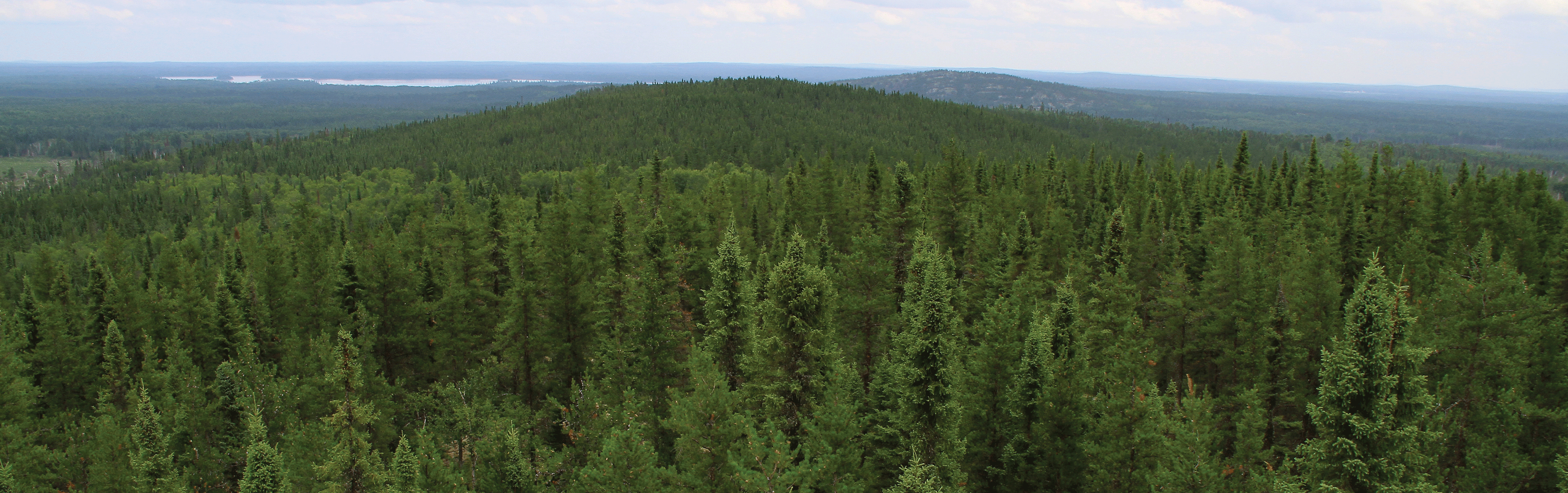
Qu’est-ce qu’une forêt communautaire?
Les peuples autochtones et les communautés locales ont été légalement reconnus comme propriétaires d’au moins 447 millions d’hectares (Mha) de terres forestières dans le monde, avec des droits légalement désignés sur 80 Mha supplémentaires, soit un total de 14% de la superficie forestière mondiale.
On estime que 36% des paysages forestiers encore intacts dans le monde se trouvent sur des terres autochtones.
Une forêt communautaire favorise l’aménagement forestier durable en s’appuyant sur :
- les valeurs locales;
- les avantages locaux;
- la prise de décisions locale.
Les forêts communautaires sont une forme unique de tenure qui diffère de la plupart des tenures forestières provinciales qui accordent des licences aux entreprises forestières pour l’exploitation à long terme de superficies forestières ou de volumes de bois en particulier sur les terres de la Couronne. La plupart des provinces et des territoires du Canada disposent d’un certain type de forêts communautaires, la majorité étant concentrée en Colombie-Britannique (BC), en Ontario et au Québec. Les définitions de la foresterie communautaire et les cadres juridiques qui la permettent varient d’une province à l’autre. Elles vont des permis spéciaux délivrés par une province à la cogestion avec une province, en passant par les entreprises communes avec l’industrie et les initiatives menées par les Autochtones. Chaque forêt communautaire est unique, car c’est la communauté locale qui l’aménage et qui fixe les objectifs en fonction de ses valeurs. Les forêts communautaires offrent également aux gouvernements et au secteur privé la possibilité de s’engager dans des partenariats avec les nations autochtones dans le secteur forestier.
Exemples de forêts communautaires au Canada
En Colombie-Britannique…
La Colombie-Britannique est unique au Canada avec sa licence forestière fondée sur la superficie, appelée Entente d’exploitation d’une forêt communautaire (EEFC). La tenure a été introduite en 1998 en réponse à une décennie de conflits sur l’aménagement forestier et aux appels à un plus grand contrôle de la part des communautés.
- La Colombie-Britannique compte actuellement 60 signataires d’EEFC couvrant entre 361 et 184 682 hectares.
- La moitié des EEFC sont conclues par des nations autochtones ou en partenariat avec des communautés non autochtones.
- Les licences sont à long terme et accordent aux communautés le droit exclusif de récolter du bois et de gérer les produits forestiers botaniques dans une zone déterminée.
- La gouvernance est assurée par des entités communautaires, notamment des sociétés communautaires, des sociétés en commandite, des entreprises et des coopératives.
Vingt-cinq ans plus tard, les titulaires de permis d’EEFC démontrent le succès de ce modèle, ce qui génère plusieurs avantages pour les communautés rurales et autochtones, notamment :
- des emplois locaux;
- des dividendes communautaires;
- des investissements en éducation, en infrastructures et en loisirs;
- des réinvestissements dans les forêts pour une meilleure intendance, l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de feux de forêt.
- En 2021, Community Forests International a annoncé une collaboration en matière d’action contre les changements climatiques (le projet Common Ground) sur le territoire non cédé des Micmacs et des Wolastoqiyiks avec l’Ulnooweg Development Group, qui soutient les initiatives autochtones et le Nova Scotia Family Forest Centre.
- La Nouvelle-Écosse a mis en œuvre un projet pilote avec la Medway Community Forest Cooperative en 2013. Au Cap-Breton, l’Unama'ki Institute of Natural Resources, qui représente cinq communautés micmaques, travaille avec la province de la Nouvelle-Écosse sur la gouvernance partagée de la Kluscap Wilderness Area. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une tendance croissante au Canada visant à promouvoir les aires protégées et de conservation autochtones (APCA).
- Au Nouveau-Brunswick, des organisations communautaires comme le Conservation Council of NB et le Falls Brook Centre font la promotion des forêts communautaires depuis des décennies. L’Upper Miramichi Community Forest Partnership s’est également efforcé de mettre en place une forêt communautaire.
- La Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador favorise les partenariats entre le gouvernement, l’industrie, le milieu universitaire et les organisations environnementales et communautaires afin de trouver collectivement des solutions pour promouvoir l’aménagement forestier durable. Les Innus du Labrador ont collaboré avec la province pour élaborer un plan d’aménagement forestier écosystémique mutuellement acceptable, qui comprend la création d’aires protégées sur la base d’un accord provisoire conclu en 2003.
- La Première Nation algonquine de Kitigan Zibi constitue un exemple intéressant de tenure et d’aménagement forestier novateurs. Sur les « terres communes » de leur propre réserve, ils se concentrent sur l’écologie et l’environnement, en favorisant la biodiversité afin d’atténuer les changements climatiques. À l’extérieur des réserves, sur les terres publiques du Québec qui font encore partie de leur territoire traditionnel, le Natural Resource and Wildlife Office exécute des contrats de sylviculture qui offrent des emplois bien rémunérés aux membres de la communauté et assurent la viabilité financière de l’Office.
- Le projet pilote de forêt communautaire de l’Ontario a duré cinq ans dans les années 1990. Au milieu des années 2000, à la suite de l’effondrement économique du secteur forestier, l’Ontario a introduit deux nouvelles formes de tenure : les permis améliorés d’aménagement forestier durable et les sociétés locales de gestion forestière. Toutes deux exigeaient un plus large éventail d’intervenants au sein des conseils de titulaires de permis, en particulier une représentation des communautés autochtones et locales. Bien que certaines des forêts puissent être considérées comme des forêts communautaires, l’Ontario n’est pas allé aussi loin que d’autres juridictions en introduisant un permis propre aux forêts communautaires.
- Dans les provinces des Prairies, des partenariats entre les Autochtones et l’industrie voient le jour. Au Manitoba, Canadian Kraft Paper et Nekoté, une société chargée de représenter sept Premières Nations, ont formé en 2018 un partenariat à parts égales, le Nisokapawino Forestry Management Corporation, pour cogérer près de neuf millions d’hectares de forêt boréale du nord du Manitoba. Il s’agit de la plus grande tenure forestière en Amérique du Nord, qui chevauche les territoires traditionnels de neuf Premières Nations.
- En Saskatchewan, Sakâw Askiy Management Inc. est un partenariat de huit groupes industriels et des Premières Nations qui détiennent l’accord Prince Albert Forest Management Agreement pour un peu plus de trois millions d’hectares de forêt boréale. Ce modèle de gestion est conçu pour donner des droits de prise de décisions opérationnelles aux personnes qui détiennent des connaissances locales.
- En Alberta, les municipalités et les organisations locales suivent une tendance nord-américaine consistant à créer des jardins-forêts communautaires urbains afin de fournir de la nourriture et des services écosystémiques comme la séquestration du carbone et la gestion de l’eau.
- La Loi sur le règlement des revendications territoriales des Premières Nations du Yukon et la Loi sur les ressources forestières prévoient la création de Conseils des ressources renouvelables (CRR). Le gouvernement territorial et les Premières Nations sont tous responsables de la sélection des membres des CRR, qui permettent aux Premières Nations d’apporter leur contribution à la gestion des ressources renouvelables. De même, dans les Territoires du Nord-Ouest, en vertu d’accords de revendications territoriales, les Premières Nations ont créé des CRR et des Conseils des ressources renouvelables pour les terres octroyées par entente. Certaines Premières Nations élaborent leurs propres plans d’aménagement forestier.
- Si la plupart des forêts communautaires sont établies sur des terres de la Couronne, nombre d’entre elles sont également situées sur des terres privées. La Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, composée principalement de propriétaires fonciers privés, en est un bon exemple.
Depuis 2002, la Colombie-Britannique a signé des ententes dans le domaine forestier, y compris des ententes d’exploitation de forêts communautaires (EEFC), avec 177 Premières Nations, ce qui représente plus de
382 millions de dollars en partage de revenus et l’accès à plus de 181 millions de m3 de bois.
Les Premières Nations de la Colombie-Britannique détiennent des tenures représentant 13 % de la possibilité annuelle de coupe de la province, alors qu’elles en détenaient moins de 3 % en 2001.
En plus des EEFC, la Colombie-Britannique a ajouté en 2019 une autre licence régionale à long terme qui a permis d’augmenter la superficie forestière aménagée par les Premières Nations : la
« First Nations Woodland Licence ».
Si les droits conférés par une EEFC se limitent à la récolte du bois, les avantages ne sont pas seulement économiques. De nombreuses EEFC vont au-delà des exigences juridiques et créent des avantages sociaux, culturels et écologiques pour leurs communautés. Cela est dû en partie à des politiques provinciales qui soutiennent la nature unique de ces tenures en offrant un certain degré d’autonomie et de flexibilité, tout en conservant une plus grande partie des avantages économiques provenant des revenus des ressources locales.
À ce jour, le succès des EEFC de la Colombie-Britannique, en tant que cadre juridique particulier permettant la création de forêts communautaires, est dû à des politiques forestières provinciales favorables, à l’ingéniosité locale, ainsi qu’à un travail de plaidoyer et de collaboration persistant au niveau local.
La BC Community Forestry Association (BCCFA) a rapporté que les EEFC ont créé 0,48 emploi local à temps plein/1 000 m3 en foresterie et exploitation forestière et en activités de soutien, soit environ 76 % de plus que la moyenne de l’industrie.
Près de 80 % des répondants au sondage de la BCCFA ont fait des contributions en espèces et/ou en nature pour un total moyen de 423 327 $, auxquels s’ajoutent 38 516 $ de contributions en nature. La contribution en nature totale s’est élevée à plus d’un million de dollars.
La BCCFA a rapporté une moyenne d’un peu plus de 100 000 $ par EEFC pour des investissements visant à améliorer ou à modifier la gestion pour des raisons écologiques ou sociales.
Une étude de cas de la nation haïda
La nation haïda de Haida Gwaii (Xaayda Gwaay.yaay), en Colombie-Britannique, a suivi sa propre voie pour placer l’aménagement des forêts sous contrôle local après avoir exprimé des inquiétudes quant au rythme et aux méthodes de récolte du bois sur l’île. Plusieurs initiatives se sont concentrées sur la création d’alliances entre les Haïdas et des communautés locales non autochtones. L’initiative « Islands Community Stability » (ICSI) a été lancée en 1995, bien avant que les ententes d’exploitation de forêts communautaires de la Colombie-Britannique ne commencent à être signées en 2000. L’ISCI a soumis une proposition de projet pilote de forêt communautaire.
Bien qu’il n’ait pas permis d’obtenir une entente d’exploitation d’une forêt communautaire, ce processus de demande a donné lieu à des négociations qui ont abouti à l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire fondé sur un cadre de gestion écosystémique, un processus qui a commencé en 2003 et a finalement été signé sous la forme du Strategic Land Use Agreement (SLUA) en 2007. Le SLUA est autant le fruit d’une opposition, de campagnes et d’une résistance civile non violente de longue date de la part des Haïdas que de négociations entre la province et les Haïdas. L’arrêté de 2010 concernant l’utilisation des terres de Haida Gwaii (l’arrêté), signé par les gouvernements de la Colombie-Britannique et de la nation haïda, a succédé au SLUA. L’arrêté incorpore la gestion écosystémique, une stratégie de gestion intégrée des ressources naturelles qui favorise l’utilisation durable et la conservation équitables.
L’arrêté se base sur la coopération et sur un fondement du droit occidental incorporant des délimitations spatiales relatives aux valeurs haïdas. Il est unique et découle directement du processus de développement de la forêt communautaire des Haïdas. L’arrêté rassemble les valeurs culturelles haïdas et les superpose sur un modèle occidental de gestion des ressources. Il s’agit d’une tentative de réconcilier les visions occidentale et haïda de l’intendance. En outre, il s’agit d’une expérience continue visant à incorporer la tradition à la modernité, dans un cadre qui, il est vrai, s’inspire largement des principes de gestion occidentaux. Les communautés de Haida Gwaii ont confiance en une relation de travail et de cogestion avec le Conseil de la Nation Haïda (CNH) et préfèrent cette solution aux exigences actuelles du ministère des Forêts, qui exige un partenariat avec BC Timber Sales. Bien que cela n’exclue pas de futures relations entre le CNH et la province de la Colombie-Britannique, cela montre que les membres de la nation haïda estiment que le CNH maintient et démontre une plus grande réceptivité aux préoccupations locales.
À peu près en même temps que la signature de l’arrêté, en 2010, la Haida Enterprise Corporation (HaiCo), le bras économique de la nation haïda, a créé Taan Forest Products. Taan a adopté la valeur haïda « yahguudang », qui signifie « respect de tous les êtres vivants et de l’interdépendance qui nous lie ». Taan a reçu une certification du Forest Stewardship Council pour ses normes rigoureuses en matière de gestion forestière.
Les décideurs tiennent compte de la définition et de la surveillance d’attributs mesurables dans l’espace par les titulaires de permis et la province. Cependant, l’approche haïda n’est pas parfaite. La capacité de la nation haïda à recueillir des informations sur les terres et les caractéristiques culturelles communautaires est limitée. La gestion occidentale l’emporte sur la gestion traditionnelle haïda dans les régions où l’utilisation des ressources est autorisée par la Colombie-Britannique. Cette mesure est compensée par la mise en place de zones tampons destinées à protéger les éléments culturels haïdas de l’exploitation des ressources et des dommages causés par la récolte du bois. Ces restrictions permettent aux Haïdas de développer une approche différente et adaptative de la gestion des ressources. L’absence de cadres juridiques propices au partage des avantages et à l’exercice d’une influence stratégique sur la prise de décisions est un obstacle à la négociation fructueuse d’ententes de collaboration.
Haida Gwaii est un exemple de la primauté de l’établissement de relations et de la confiance pour la mise en œuvre de la gestion écosystémique et de la prise de décisions partagée. Si la gouvernance est compliquée par le contexte local, elle est en constante évolution et n’est pas universelle. La reconnaissance des entités culturelles haïdas et le mandat commun de surveillance et d’évaluation des pratiques actuelles d’exploitation forestière sont essentiels pour rompre avec l’histoire du colonialisme, de la méfiance et de la discrimination dont le peuple haïda a fait l’objet. Les Haïdas continuent de suivre leur propre voie avec la province de la Colombie-Britannique par le biais d’une série d’ententes stratégiques et opérationnelles, ce qui prouve qu’il existe de nombreuses façons de définir la « foresterie communautaire ».
À travers le Canada…
Une voie à suivre pour la foresterie communautaire au Canada
De plus en plus de communautés, autochtones ou non, souhaitent que les forêts locales soient aménagées d’une manière qui réponde à leurs valeurs et à leurs attentes. Nombre d’entre elles tirent les leçons des succès et des défis des forêts communautaires existantes et cherchent à obtenir des droits d’aménagement forestier pour leurs communautés. Près de 30 ans plus tard, il est nécessaire de poursuivre le plaidoyer, l’apprentissage des politiques et les réformes des politiques forestières si les gouvernements veulent soutenir d’autres forêts communautaires prospères. Les réformes comprennent la redistribution des droits d’exploitation aux communautés autochtones et rurales, la promotion de changements dans les règlements d’aménagement forestier qui réduisent l’accent mis sur la gestion du bois, favorisent la gestion des produits forestiers non ligneux et des services écosystémiques et élargissent la portée des droits de gestion afin de permettre plus d’autonomie et de flexibilité pour les solutions locales.
Il reste nécessaire d’élargir la diversité des ententes de tenure et d’améliorer la qualité des interactions entre les intervenants non autochtones et les nations autochtones. La réconciliation fondée sur la reconnaissance des droits des Autochtones, l’acceptabilité sociale et la confiance s’obtiennent une conversation à la fois.
Les provinces et le gouvernement fédéral ont un rôle à jouer dans le soutien des forêts communautaires. Les forêts communautaires constituent une approche collective de gestion durable des forêts, fondée sur la reconnaissance des droits des Autochtones, le partage des avantages et la prise de décisions au niveau local.
Détails de la page
- Date de modification :